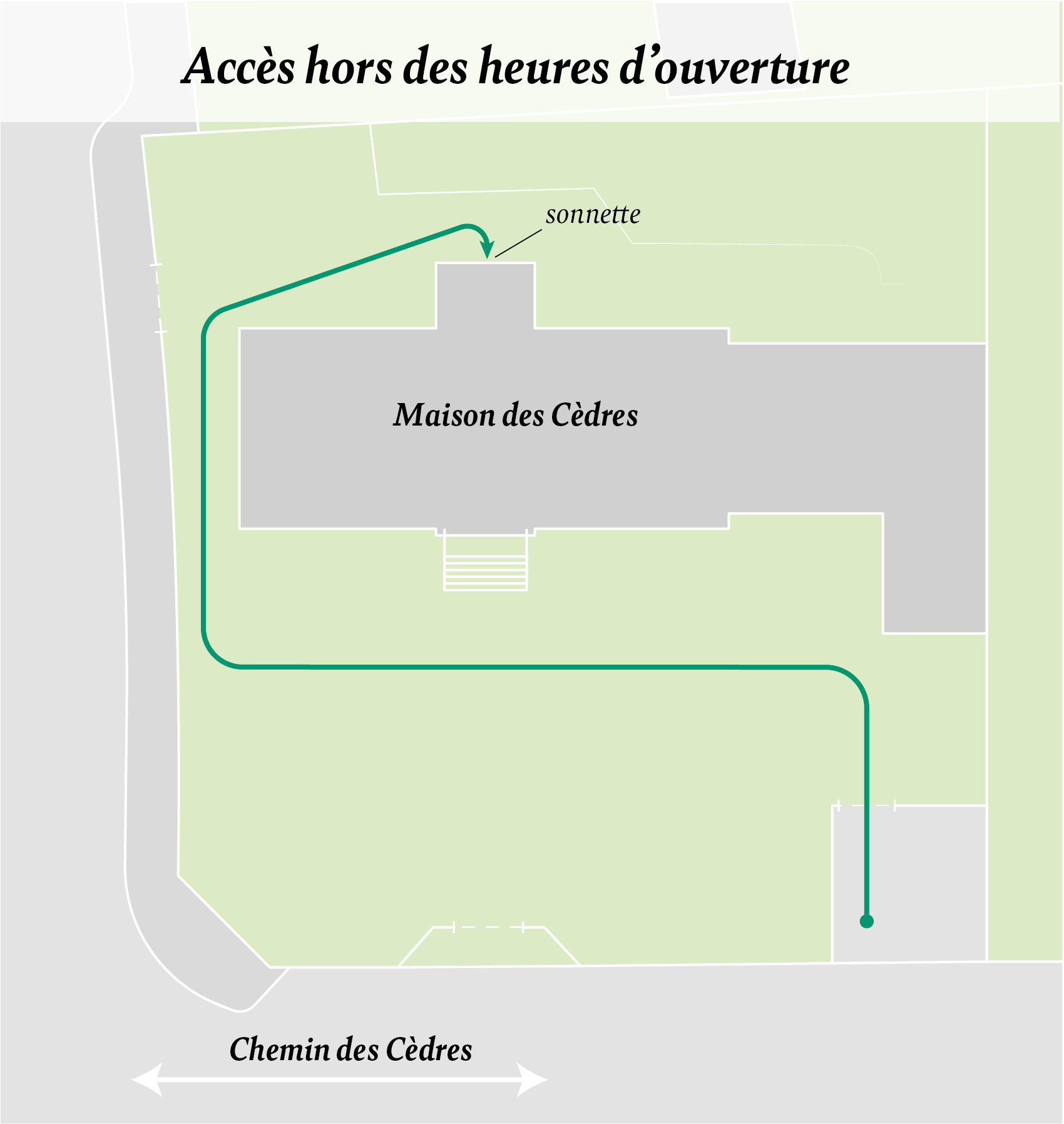La théologie n’est pas autre chose que la poésie de Dieu.
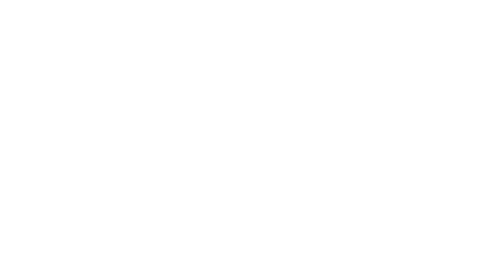
Formations théologiques et spirituelles
Nous publions une Revue de vulgarisation théologique
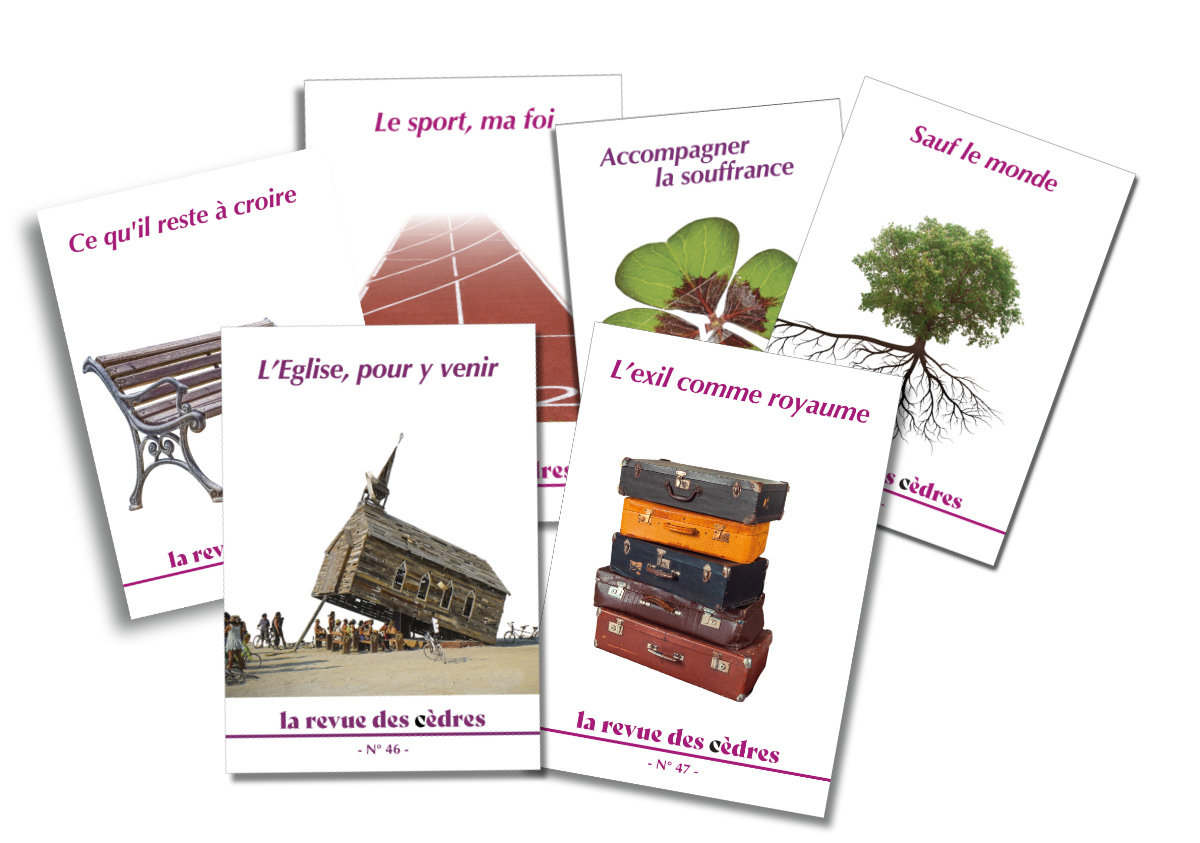

Basé à Lausanne (Suisse)
En quelques mots
Nos cours et formations s’adressent aussi bien à des personnes croyantes et engagées qu’à des personnes qui ne se considèrent pas comme telles. Aucun prosélytisme n’est admis. Le diplôme du Séminaire de culture théologique permet d’envisager de travailler dans une Église réformée romande (comme diacre ou animateur.trice d’Église).
Notre mission
nous générons des parcours de formation en théologie, spiritualité, disciplines bibliques, certifiants ou non
nous sommes enracinés dans la tradition réformée et ouverts à la diversité des confessions chrétiennes
nous tenons beaucoup à la qualité de nos formations. Nos formateurs·trices et enseignant·es sont titulaires de formations académiques
nous sommes rattachés à l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, institution liée à l’État
nous travaillons avec des partenaires de la société civile et du monde œcuménique
nous accordons un soin particulier au respect de la personne, de ses convictions, de son itinéraire et de son enracinement
Notre équipe

Jean-Christophe Emery
Théologien, formateur d’adultes
Directeur

Dimitri Andronicos
Théologien, éthicien
Co-directeur

Anne Alberti
Sc. rel., anthropologue
Assistante de dir.

Charlotte Eidenbenz
Lic. lettres
Assistante administrative

Sara Schulthess
Dre théol., pasteure
SCT – Monde de la Bible

Apolline Thromas
Théologienne
SCT – Monde de la Bible
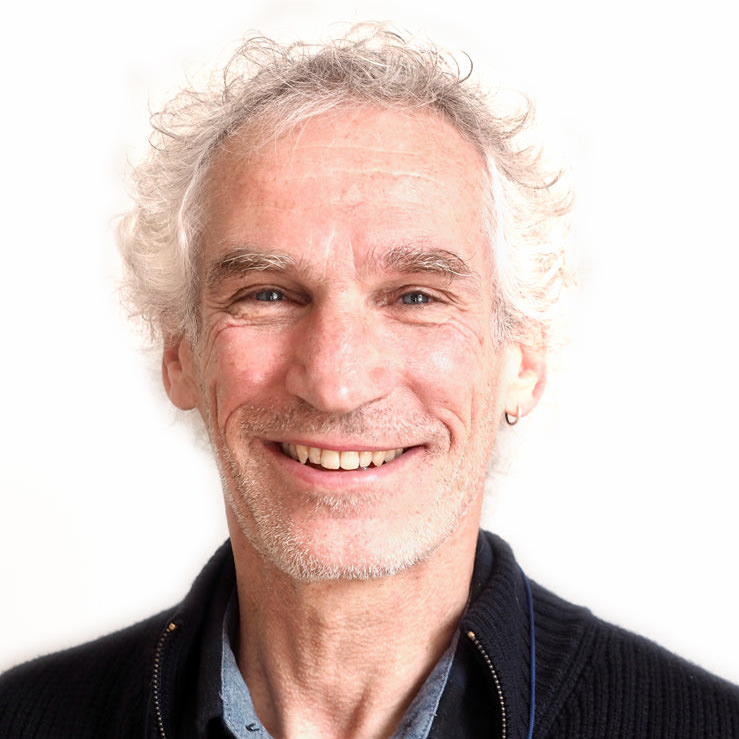
Bernard Bolay
Théologien, pasteur, formateur d’adultes
SCT – Exégèse

Sarah Scholl
Prof. UniGE
SCT – Histoire

Anthony Feneuil
Prof. Uni. Lorraine
SCT – Systématique

Miriam Jaillet
Théologienne,
SCT – Auxiliaire pédagogique

Anne Schneider
Dipl. SCT
Acc. spirituelle

Nicole Bonnet
Théologienne, pasteure
Accompagnatrice FAST

Claire-Sybille Andrey
Dre théol., pasteure,
Accompagnatrice FAST, cours de langue

Thora Constant
Historienne de l’art, Art thérapeute
Accompagnatrice FAST

Aurélie Netz
Sc. sociales et rel., anthropologue, aumônière
Accompagnatrice FemFAST

Maude Bertrand
Dipl. SCT
FAB – formation biblique

Jean-François Habermacher
Théologien, pasteur
Club Cèdres

René Blanchet
Théologien, pasteur
Club Cèdres
Bribes d’histoire
Inaugurée en 1864, la Faculté de théologie de l’Église libre est le témoin d’une époque de division au sein du protestantisme réformé. Un courant dit « libriste » refuse les liens à l’État revendiqués par l’Église Nationale. Les pasteurs de l’Église libre dans le Canton de Vaud se forment alors dans ce bâtiment appelé « la Môme » en référence au sobriquet dont les libristes sont affublés.
En 1966, la fusion des courants dissidents donne naissance à l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Les locaux abritent une importante bibliothèque, aujourd’hui reprise par la Bibliothèque Cantonale Universitaire (Lausanne). Le Séminaire de culture théologique y forme des diacres dès sa fondation en 1962.
En pratique
Contact
Cèdres formation
Ch. des Cèdres 7
1004 Lausanne
Suisse
+4121 331 58 55
info@cedresformation.ch
CCP : 17-628272-5
IBAN : CH26 0900 0000 1762 8272 5
Cèdres formation